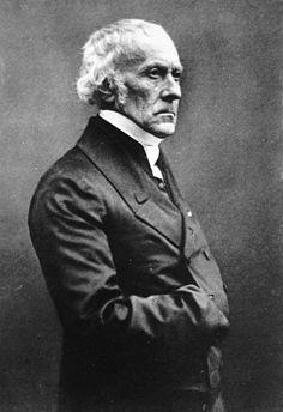« Aujourd'hui, à mon âge, être un jeune comédien, c'est fantastique. Apprendre un nouveau métier, voir des nouveaux gens, avoir une nouvelle ambition. C'est ça qui est fantastique dans la vie ! » (Jean-Louis Debré, le 28 janvier 2023 sur France Culture).
Enfant de la République. La Cinquième. Pas de Beethoven, mais de De Gaulle, bien sûr. Jean-Louis Debré fête ses 80 ans ce lundi 30 septembre 2024. Il les fête seul, je veux dire, il les fête sans son frère jumeau Bernard Debré qui est parti il y a quatre ans. Cela doit faire quelque chose d'être amputé d'un frère si proche (et en même temps qui était si différent).
Au regard de sa carrière politique, on peut dire que Jean-Louis Debré a eu une belle trajectoire, il est un baron de la République, il a eu des postes prestigieux, dont trois qui ont dû faire honneur à son père premier Premier Ministre de De Gaulle (qui n'en a vu qu'un de son vivant) : Ministre de l'Intérieur de 1995 à 1997 (prime au fidèle et loyal, mais un ministre peu convaincant), Président de l'Assemblée Nationale de 2002 à 2007 (beaucoup plus convaincant), enfin Président du Conseil Constitutionnel de 2007 à 2016 (très convaincant).
Il ne faut pas croire que c'était parce qu'il est issu d'une très grande famille républicaine, de médecins et de responsables politiques, qu'il a eu tout tout cuit sur un plateau d'argent. J'ai déjà évoqué longuement sa carrière ici. Né à Toulouse, diplômé de l'IEP Paris, il a fait un doctorat spécialisé en droit constitutionnel (son directeur de thèse était Roger-Gérard Schwartzenberg, à peine plus âgé que lui). Sa future fonction à la tête du Conseil Constitutionnel est donc non seulement la consécration de son engagement politique mais aussi celle de sa carrière de juriste. Après ses études, il fut membre de cabinets ministériels, juge d'instruction, député, maire d'Évreux, etc.
Sans doute que, plus que son lien de filiation avec Michel Debré, sa relation faite d'amitié et de loyauté absolue envers Jacques Chirac dans une époque de trahisons (balladuriennes) a quelque peu encouragé sa carrière. Amitié avec Jacques Chirac dont il est devenu un confident jusqu'au bout de la nuit, quand tout s'effaçait, tout s'oubliait. Amitié aussi avec Pierre Mazeaud, son prédécesseur immédiat au Conseil Constitutionnel, qui date des années 1960, une amitié familiale surtout.
Il a commencé à se présenter aux élections en mars 1973, à l'époque, il avait 28 ans. Dans un reportage dans le journal d'Antenne 2 le 11 février 1973, on le voit ainsi faire campagne assez timidement pour les élections législatives, sans succès. L'une de ses paroles, c'était de dire que s'il s'était servi de sa famille, il aurait choisi une circonscription plus facile.
C'est un peu cela, Jean-Louis Debré, un homme qui, faute de s'être fait un nom (l'ascendance familiale était trop lourde), a su se faire un prénom. Ayant travaillé pour Jacques Chirac dans les années 1970, il lui était resté fidèle malgré les relations parfois orageuses entre le futur Président de la République et son propre père (ils étaient concurrents à l'élection présidentielle de 1981). Cette fidélité s'est renforcée au moment de la grande rivalité avec Édouard Balladur, et il s'est retrouvé dans le camp des vainqueurs en 1995 : peu de leaders du RPR avaient su soutenir Jacques Chirac, les plus ambitieux préféraient le trahir sur l'autel de leur carriérisme.
À cette époque, j'appréciais peu Jean-Louis Debré : il n'était qu'un second couteau et montrait un aspect très militant et politicien, avec ses éléments de langage, sa langue de bois, sa mauvaise foi. C'est assez commun et on a pu l'observer chez de nombreux dirigeants politiques, au RPR notamment, de Nicolas Sarkozy à Alain Juppé en passant par Jean-François Copé. L'exercice de son ministère Place Beauvau a été un désastre pour la lutte antiterroriste. Il n'était visiblement pas à sa place.
Heureusement, il a eu une seconde chance ! Il a donné sa mesure personnelle quand il a été élu au perchoir. D'abord, il l'a été sur son propre mérite et avait un adversaire de taille en 2002 : Édouard Balladur, ancien Premier Ministre, et ancien favori d'une élection présidentielle sept ans auparavant. C'est la victoire du passionné sur le plus médaillé, un peu comme la victoire de Gérard Larcher sur Jean-Pierre Raffarin en 2008, au Plateau (Présidence du Sénat).
Jean-Louis Debré a été effectivement un excellent Président de l'Assemblée Nationale, ouvrant l'institution sur le monde extérieur, modernisant les procédures, etc. Et sa Présidence n'était pas partisane, il défendait désormais les institutions, l'Assemblée Nationale, avant de défendre son camp politique, son parti, surtout lorsque celui-ci est tombé sous la tutelle de Nicolas Sarkozy qu'il n'a jamais apprécié (au point de voter pour François Hollande en 2012 !).
Au fur et à mesure qu'il est devenu une autorité de référence dans une République en perte de référence, Jean-Louis Debré se permettait de prendre plus de distance. Tant de ses anciens amis gaullistes que des autres. Sa prise de distance n'était pas nouvelle et pas seulement sous Nicolas Sarkozy. Il s'était émancipé de Jacques Chirac dès 1997 lorsqu'il a pris à l'arraché la présidence du groupe RPR à l'Assemblée Nationale, en opposition au gouvernement de cohabitation de Lionel Jospin, malgré les réticences de Jacques Chirac lui-même, puis le perchoir en 2002 malgré les appétits de deux Premiers Ministres, Alain Juppé et Édouard Balladur (et les mêmes réticences de Jacques Chirac).
En 2017, il n'hésitait pas à annoncer qu'il voterait Emmanuel Macron aux deux tours de l'élection présidentielle (s'opposant à François Fillon), mais plusieurs années plus tard, il ne s'interdisait pas de critiquer ouvertement le jeune Président de la République, proposant, dans "Le Parisien" du 15 juillet 2023, une dissolution ou un référendum pour rompre avec la crise politique (considérant que les Français se moqueraient d'un changement de gouvernement ou d'un remaniement) : « Vous ne pouvez pas passer des textes aussi importants que la réforme des retraites sans avoir une consultation populaire. (…) Les Français n’ont rien à fiche des changements de ministres. D’ailleurs, on n’en connaît que quatre ou cinq. ».
Sa Présidence du Conseil Constitutionnel (2007-2016) a été également cruciale pour cette instance suprême car Jean-Louis Debré a dû adapter l'institution à la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui comporte une innovation majeure : le contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori (après leur promulgation et leur application) sur saisine des citoyens eux-mêmes (s'ils sont justiciables). Ce sont les fameuses QPC (questions prioritaires de constitutionnalité) qui ont bouleversé les missions du Conseil Constitutionnel en lui donnant beaucoup plus de travail qu'auparavant (ses missions d'origine étant la constitutionnalité des projets de loi avant promulgation seulement sur saisine des parlementaires et la validation des élections nationales).
Le 13 novembre 2015, il confiait d'ailleurs à Capucine Coquand pour le journal "Décideurs Magazine" que sans ce défi de la QPC, il aurait quitté ses fonctions car cela l'aurait ennuyé : « Sans cela, je ne serais probablement pas resté Président du Conseil Constitutionnel. C’est une avancée significative pour la Ve République et les justiciables, pour notre État de droit. (…) L’institution n’est plus la même que celle que j’ai trouvée en arrivant avec plus de décisions en cinq ans qu’en quarante-neuf ans, le nombre inchangé de fonctionnaires mais de très grand professionnalisme ou la construction d’une nouvelle salle d’audience qui marque la juridictionnalisation de cette institution, un greffe performant, des audiences publiques, des avocats qui plaident... Jamais la maison n’a été aussi ouverte sur l’extérieur notamment vers les étudiants en droit, concours de plaidoiries, salon du livre juridique… (…) [Les dépenses] ont été réduites de 23% alors que nous travaillons beaucoup plus. ».
Sa plus grande fierté demeure l'indépendance du Conseil Constitutionnel : « Car nous n’avons pas hésité à annuler les comptes de campagne d’un candidat à la Présidence, là où l’un de mes prédécesseurs avait préféré faire la sourde oreille. Nous ne craignons pas un instant de retoquer une surtaxe de 75%, figurant pourtant parmi les promesses d’un candidat à la présidentielle. C’est ça l’indépendance ! Et elle s’illustre symboliquement. Aujourd’hui, il n’y a plus un seul portrait des anciens Présidents de la République : ils ont tous été remplacés par des Marianne. (…) Mon plus grand souvenir, c’est lorsque nous avons annulé la loi de 1838 sur l’hospitalisation sans consentement. Ce jour-là, j’ai pensé à Camille Claudel hospitalisée contre son gré pendant trente ans. On l’a laissée mourir dans un hospice. C’est aussi ça la QPC : rétablir la justice. ».
Le 5 juin 2023, répondant à l'invitation de l'Association pour l'histoire des Caisses d'Épargne, Jean-Louis Debré donnait sa définition du vivre ensemble dans la République : « "Un rêve d’un avenir partagé" comme le formulait Ernest Renan. La République n’est pas un modèle figé ; c’est une volonté de vivre ensemble. Aspirer à un destin commun suppose des mutations et des ruptures, des compromis et des anticipations. La société est en perpétuelle évolution, des attentes nouvelles apparaissent. Plus que jamais nous avons besoin d’une République audacieuse. ».
C'est sans doute cette audace et ce besoin de se renouveler qui l'ont fait changer de vie. Jean-Louis Debré a définitivement quitté la vie politique, il n'est plus acteur mais observateur politique, publiant des livres de souvenirs, de témoignages, d'anecdotes... qui pourraient presque s'apparenter à de l'antiparlementarisme primaire si on ne connaissait pas son auteur ! De la taquinerie faite de tendresse et de passion plus que de la haine du système politique dont il défend les principes essentiels. Et certainement aucune rancœur nostalgique.
Jugeons-en avec ses paroles du 28 janvier 2023 sur France Culture : « Aujourd'hui, le système politique ne génère plus de grands personnages comme jadis. Et la politique est devenue un métier du spectacle. Et peu importe ce que l'on dit, c'est la manière de le dire. Je suis sidéré de voir comment, comme les concitoyens, nous vivons tous dans l'immédiateté. Comment on peut dire tout et son contraire en quelques jours. (…) Le monde politique d'aujourd'hui n’est plus mon monde. Je ne le comprends pas. Je regarde ça avec un très grand détachement. (…) Quand je regarde les discours aujourd'hui des responsables politiques, il n'y a rien, il n'y a aucune ambition, il n'y a aucune foi et aucune passion. Ce sont des mots que l'on a alignés. On lit une note faite par ses collaborateurs. ». Et de conclure : « Je pense qu'il doit y avoir un Président qui assure l'unité nationale et qui est une personnalité importante. Et face à cela, un Parlement qui discute et qui modifie. ».
Après les élections législatives anticipées, Jean-Louis Debré n'était guère plus tendre avec la classe politique, disant à Francis Brochet le 24 juillet 2024 pour "Le Dauphiné libéré" : « [Les Français] ressentent de l’angoisse pour l’avenir, de la tristesse pour le présent. Ils ont eu une mobilisation extraordinaire pour les législatives, ils voulaient de la sérénité, qu’on se remette au travail pour régler les problèmes économiques et sociaux et le problème de l’insécurité. Les politiques n’ont rien compris, ils chipotent et se font des croche-pieds. (…) La responsabilité incombe à l'ensemble du personnel politique. ».
Il n'est plus acteur politique, je dois préciser, mais il est devenu acteur tout court, jeune acteur, jeune comédien. En 2022, il a donc radicalement changé de vie car le voici sur les planches avec sa compagne Valérie Bochenek pour honorer les femmes qui ont fait la France (il s'est même produit au Liban), avec ce titre : "Ces femmes qui ont réveillé la France", titre du livre qu'il avait coécrit avec sa compagne dix ans auparavant. Cela fait deux ans qu'il parcourt la France pour évoquer ces femmes françaises : le voici maintenant octogénaire. Amoureux de la France et des femmes.
Aussi sur le blog.
Sylvain Rakotoarison (28 septembre 2024)
http://www.rakotoarison.eu
Pour aller plus loin :
Bernard Debré.
Haut perché.
Michel Debré.
Jean-Louis Debré.
Yaël Braun-Pivet.
Richard Ferrand.
Il faut une femme au perchoir !
François de Rugy.
Claude Bartolone.
Patrick Ollier.
Raymond Forni.
Laurent Fabius.
Philippe Séguin.
Henri Emmanuelli.
Louis Mermaz.
Jacques Chaban-Delmas.
Edgar Faure.
Édouard Herriot.
Vincent Auriol.
Paul Painlevé.
Léon Gambetta.
https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20240930-jean-louis-debre.html
https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/jean-louis-debre-enfant-de-la-256647
http://rakotoarison.hautetfort.com/archive/2024/09/28/article-sr-20240930-jean-louis-debre.html
/image%2F1488922%2F20240930%2Fob_8617b8_yartidebrejeanlouisb01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240930%2Fob_edc5c6_yartidebrejeanlouisb05.jpg)
/image%2F1488922%2F20240930%2Fob_95acb2_yartidebrejeanlouisb02.jpg)
/image%2F1488922%2F20240930%2Fob_f72709_yartidebrejeanlouisb06.jpg)
/image%2F1488922%2F20240926%2Fob_0b059e_yartichiracvge01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240926%2Fob_a6e8d1_yartichiracvge04.jpg)
/image%2F1488922%2F20240926%2Fob_619fe1_yartichiracvge05.jpg)
/image%2F1488922%2F20240925%2Fob_522d23_yartichiracvge08.jpg)
/image%2F1488922%2F20240924%2Fob_0ac995_yartiduhameljacques01.jpg)

/image%2F1488922%2F20240924%2Fob_044e7c_yartiduhameljacques02.jpg)
/image%2F1488922%2F20240924%2Fob_7d2acd_yartiduhameljacques04.jpg)
/image%2F1488922%2F20240924%2Fob_bb0586_yartiduhameljacques03.jpg)
/image%2F1488922%2F20240924%2Fob_55f40f_yartiduhameljacques06.jpg)
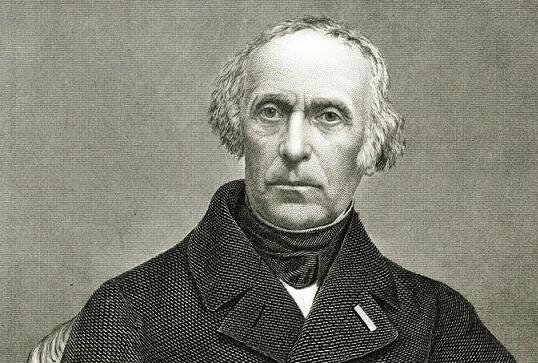
/image%2F1488922%2F20240911%2Fob_ffe051_yartibarniermichelc02.jpg)